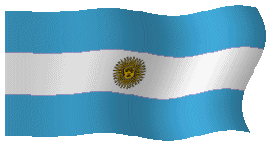 Nom Officiel : République Argentine
Nom Officiel : République Argentine
Capitale : Buenos Aires
Superficie : 2.766.890 km²
Langue : Espagnol
Population : 39.144.753 (2004) issus en grande partie des immigrants espagnols, italiens, allemands arrivés surtout depuis la fin du 19ème siècle et le début du 20ème.
Un tiers de la population se concentre dans la capitale et son agglomération (Gran Buenos Aires). Les habitants de Buenos Aires sont appelés les porteños, "ceux du port". Les principales zones urbaines sont Cordoba, Rosario et Mendoza.
La population indigène est peu importante et se trouve au sud de la Patagonie, dans les régions du nord de Jujuy, Chaco et Misiones, et au Nord Ouest, dans la Cordillère des Andes.
Densité : 14 hab./ km²
Indépendance : 9 Juillet 1816
Monnaie : Peso argentin divisé en 100 centavos. Actuellement, un peso argentin $Ar = 0,23 € soit pour 1€, 4.35 $Ar.
Trois zones sont clairement différenciées : au nord se trouve la pampa, de grandes plaines fertiles ; la Patagonie au sud et la Cordillière des Andes à l'ouest dont le point culminant, l'Aconcagua, se situe à 6 959 mètres d'altitude. Au nord-est, on se retrouve dans une région tropicale dans les provinces de Misiones, Mesopotamia et Chaco.
La Terre de Feu : C'est un archipel dont la plus grande île est la Isla Grande et c'est elle que l'on associe à la Terre de Feu. L'Argentine en occupe seulement un tiers, le reste est chilien. Le détroit de Magellan est entièrement chilien. La Isla Grande est séparée du continent par le détroit de Magellan, lequel Magellan y arriva en novembre 1520 (souvenez-vous, dans carnet de route Espagne, je parlais de son départ de Sanlucar de Barrameda en 1519). Il mit 5 semaines pour traverser le détroit tant la mer était agitée. Ushuaia qui signifie "baie qui pénètre l'ouest", est au bord du canal de Beagle. Beagle était le nom du bateau de Charles Darwin lors de son tour du monde en 1831. Les îles en face d'Ushuaia sont chiliennes, ce qui fait que le canal de Beagle, à ce niveau est moitié argentin et moitié chilien.
Parc national des glaciers : Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Tous les glaciers du parc sont les terminaisons du Hielos Continentales, immense glacier de 500 km de long à cheval sur l'Argentine et le Chili. Le Perito Moreno mesure 15 km de long, 5 de large et 60 mètres au-dessus du niveau du lac. Le Perito Moreno alimente le lago Argentino et ses glaces très vieilles et très denses lui donne une couleur bleue turquoise et laiteuse grâce à l'apport de sédiments. La particularité du glacier Perito Moreno, c'est qu'il est à seulement 300 mètres d'altitude alors que dans l'hémisphère nord, il faut aller à plus de 3000 mètres pour voir un tel glacier. Il avance de 2 mètres par an au centre et vient buter sur la presqu'île, bloquant ainsi l'eau de la rivière dans le brazo Rico. La pression de plus en plus forte finit par briser cette digue, c'est "la rupture" qui se produit environ tous les 4 ans, la dernière a eu lieu en mars 2004.
La glace se forme au haut des montagnes à 2000 mètres d'altitude et avance en épousant le relief des versants. L'eau qui s'écoule en permanence sous le glacier le fait avancer. En aval, la glace se détache et tombe dans le lac. Le glacier Périto Moreno est stable, contrairement à de nombreux glaciers qui de nos jours reculent (c'est-à-dire qu'il disparait plus de glace qu'il ne s'en forme).
Aconcagua : De son vrai nom Acon Cahuac, "sentinelle de pierre" en langue quechua. Altitude 6962 mètres. L'ascencion par la face ouest est "relativement" facile, alors que par la face sud, ce n'est que de l'escalade sans possibilité de bivouac. Ceux qui la tente dorment "accroché" à la paroi... Les indiens sont monté là-haut bien avant nous : il y a quelques années, une momie inca a été trouvée à 5300 mètres.
Parc Ischigualasto : Parc provincial de la région de San Juan, classé au patrimoine naturel mondial de l'humanité par l'UNESCO. Ischigualasto signifie "terre sans vie" en quechua. Mais pendant le triasique, (il y a entre 180 et 250 millions d'années), avant la formation des Andes, cette région était recouverte d'une végétation luxuriante grâce à l'humidité apportée par l'océan pacifique. Les dinosaures peuplaient cette région. Et puis les Andes se sont formées, plus de pluie, plus de végétation, plus de dinosaures. Fin de la vie, début des fossiles. On a trouvé ici des squelettes de dinosaures jamais trouvés ailleurs. Aujourd'hui, il règne ici un climat désertique : 100mm d'eau par an, des températures dépassant 40° le jour en été et seulement 10 la nuit mais aussi des nuits d'hiver à moins 10°. Ce qui nous parait être de la roche n'est que du sable blanc gris aggloméré. Le vent soufflant en permanence à 40 km/h sculpte inlassablement ces masses minérales et l'imagination humaine donne des noms à ces formes étranges : un jeu de boules, un sous-marin, un champignon, le sphinx. On enregistre ici une trentaine de secousses sismiques par jour, la plupart imperceptibles. Cet univers protégé est donc précaire : la lampe d'Aladin est tombée et les sculptures que nous avons observé aujourd'hui peuvent encore être là dans des années comme disparaître demain. Seule touche de couleur dans ce parc : la barranca colorada d'un rouge profond souligne l'horizon.
Parc Talampaya : Talampaya signifie fleuve sec du Tala. De formation identique au précédent. C'est le canyon du fleuve Talampaya qui ne coule que quelques heures après de brèves pluies. C'est donc dans le lit du fleuve que la piste est tracée sur une cinquantaine de kilomètres. Ici, la couleur rouge due à l'oxyde de fer domine. Comme pour le précédent, le vent sculpte inlassablement des formes étranges. Les endroits humides permettent à une végétation endémique de survivre. De nombreux pétroglyphes ont été trouvés ici, pour certains de 500 ans avant JC. Ici aussi ont été trouvés de nombreux fossiles de dinosaures alors que la faune d'aujourd'hui est composée de renards gris, guanacos, pumas et condores.
Le soja : La culture du soja prend de plus en plus de place en Argentine. La région de Cordoba où nous avons séjourné était jusqu'à il y a peu une région d'élevage. Peu à peu, les propriétaires préfèrent cultiver le soja qui apparemment rapporte plus et plus vite. Malheureusement, le soja est une culture qui appauvrit très vite la terre, la rendant ensuite inculte pour 10 à 15 ans. Sur les clôtures, on peut voir des panonceaux Monsanto, Roundup et autres gros trusts de produits chimiques en tous genres qui ne rassurent guère. Mais le paradoxe, c'est que l'Argentine n'a pas besoin de soja et exporte la quasi totalité de la production. Et où ça ? Une grande partie en France, les éleveurs français ayant besoin de tourteaux de soja pour nourrir le bétail...Cherchez l'erreur !
Les indiens Quilmes : L'origine du village est aux environs de l'an mil. Le village était construit dans une sorte d'amphithéâtre naturel s'élevant à flanc de coteau. Les quilmes élevaient le lama et cultivaient le maïs. Ils ont résisté aux incas (1480) puis pendant 130 ans aux espagnols qui voulaient les chasser de leurs terres. Lorsqu'ils furent vaincus en 1667, les espagnols les déportèrent à Buenos Aires pour construire la ville.
Les missions jésuites :
De 1607 à 1767, les jésuites ont réalisés ici une expérience sociale, culturelle et religieuse unique. Les guaranis, las d'être soumis à l'encomienda, le droit pour les planteurs de prélever dans cette population la main d'oeuvre nécessaire à leurs exploitations, préférèrent la sécurité de ces communautés où ils jouissaient d'un certain respect. Forts d'avoir observer le mode de vies de ces populations et appris leur langue, les jésuites évangélisèrent et apportèrent comme seules modifications la suppression de la polygamie et le mode d'inhumation (les guaranis inhumaient en position foetale). Dans ces villages, les guaranis cultivaient une parcelle de terre pour leur usage familial et les parcelles de la communauté...Ils participaient également à la construction des églises et des maisons. Il y avait un chef de village qui avait le pouvoir civil. Rassemblés dans ces villages, ils furent ainsi la cible des portugais et des métis qui trouvaient là une source d'esclaves faciles à revendre au Brésil. Armés par les jésuites, les guaranis, véritables guerriers, écrasèrent les portugais et les firent renoncer à cette pratique. Trente villages furent ainsi créés, 7 au Brésil, huit au Paraguay et quinze en Argentine dont douze se trouvent dans la région de Misiones, six étant classées patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Pendant la première moitié du XVIII siècle, les missions furent florissantes et assurèrent aux jésuites un revenu non négligeable sans doute souvent investi dans des oeuvres d'art. Mais le roi d'Espagne voyait d'un mauvais oeil cet état dans l'état et le pouvoir grandissant des jésuites ; l'ordre fut dissous en 1767, les missions passèrent sous la tutelle des franciscains mais ceux-ci ne réussirent pas à prolonger l'oeuvre des jésuites. Les guaranis furent priés de quitter les missions, mais ne comprenant pas la raison, ils se révoltèrent et beaucoup moururent dans les combats qui s'en suivirent. Les survivants retournèrent vivre dans la forêt ou furent déportés.
Les chutes de l'Iguazu :
Iguazu signifie eau grande en guarani. Avec les chutes Victoria et celles du Niagara, ce sont les plus belles du monde. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Environ 275 chutes sur un front de 2,5 kilomètres se déversent dans une végétation tropicale, hautes de 72 mètres, celle du Niagara n'en faisant que 47. Le rio Iguazu sert de frontière entre l'Argentine et le Brésil. A Puerto Iguazu, il se jette dans le Parana, qui en amont délimite la frontière entre le Paraguay et le Brésil et en aval entre le Paraguay et l'Argentine. A Puerto Iguazu, c'est le point des trois frontières.
San Telmo :
Jusqu'à la fin du XIX siècle, c'était le quartier chic de Buenos Aires. Les épidémies firent des ravages et les habitants changèrent de quartier. Puis les flux migratoires ont ranimés le quartier, les belles demeures aristocratiques ont été divisées en appartements. Il suffit de lever le nez pour voir des chefs d'oeuvre que des associations essaient de rénover afin de conserver ce patrimoine architectural.
La Boca :
C'est l'histoire d'un bébé abandonné et recueilli par une famille pauvre du quartier. Quinquela Martin grandit là et devient un peintre célèbre dans les années 1930. Il fait alors construire une école dans ce quartier pauvre et demande à tous les habitants de venir en peindre les murs. Chacun vient avec son pot et évidemment de couleurs différentes. Le style la Boca est né ! Les habitants trouvent cela très gai et décident d'en faire autant sur leur maison de bois ou de tôles, essentiellement rue Caminito. Aujourd'hui, les maisons sont toujours aussi colorées, même si l'endroit a perdu un peu de son authenticité.